Jan Kobow - Schubert: Die schöne Müllerin
Il est des phénomènes sociaux dont on néglige l’influence
tant elle paraît superficielle à la postérité. Ainsi, les
ultimes mélodies que Schubert a consignées ne sont-elles
venues à notre connaissance que par la mode alors si
récente et fort populaire des recueils de mélodies, ou parfois
aussi de cycles. Conscient de la ferveur du public — et
des éditeurs ! — envers cette nouvelle manière de
présenter les lieder, Schubert a donc clairement eu en
tête de réunir les sept textes de Rellstab, comme les six
poèmes de Heine en collections qu’il pensait soumettre
aux éditeurs afin de remédier rapidement à sa piètre situation
financière. On tient même un autographe d’août
1828 qui soutient cette thèse.
Que la mort l’ait empêché de mener à bien ce projet est
une autre histoire ; que son ami et éditeur Haslinger, à qui
il vient tout juste de remettre les corrections du second
cahier de Voyage d’hiver (D. 911), les publie dans l’ordre
indiqué par Schubert tient donc de la fidélité la plus
sincère. Si ces deux « projets » sont nettement plus courts
que les deux précédentes réussites de Schubert dans le
genre (La belle meunière et Voyage d’hiver), c’est pour
parer à la critique viennoise qui lui reproche acerbement
de « faire trop long ».
La seule petite entorse à la rigueur musicologique de
l’éditeur réside en l’adjonction d’un quatorzième et dernier
lied, Die Taubenpost (Le pigeon voyageur). Ici cependant, le
choix de Haslinger ne sait susciter nul reproche ; il s’agit bel
et bien de la dernière mélodie composée par Schubert
(octobre 1828). Si son ton semble détonner avec la terriblenoirceur des textes de Heine qui la précèdent exactement dans l'édition de Haslinger, on
ne saurait artistiquement penser, surtout à cette époque, clore un recueil de manière aussi
violente qu’avec l’horreur du Doppelgänger (Le double) qui vient tout juste de résonner.
De plus, l’image poétique du texte s’avère très appropriée : le pigeon voyageur s’en va,
doucement, sans rien demander, et qui garde à son maître aimé une place dans son coeur
fidèle (l’imagerie se transpose aisément dans bien des domaines socio-affectifs).
Le premier cahier (ce qu’on tient pour la première moitié du « cycle ») est constitué
de poèmes de Rellstab, des textes que le poète avait offerts à Beethoven. À la mort de
ce dernier, son factotum, Anton Schindler, les met entre les mains de Schubert. S’il fallait
prouver l’importance de la reconnaissance dont jouit Schubert à cette époque, ce
moment où Schubert prend de plus en plus conscience de sa propre valeur, point n’est
besoin d’aller chercher plus loin. Le mythe du compositeur ignoré vient de s’effondrer
puisqu’on le juge seul digne d’« hériter » des projets beethovéniens. Ainsi, Schubert
tente de rendre un véritable et somptueux hommage au feu maître. Quant aux textes
de Heine, Schubert les découvre lors d’une soirée de lecture en janvier 1827 chez son
ami Schobert. Schubert est non seulement lecteur infatigable, il possède en plus une
profonde acuité de compréhension de la poésie — surtout contemporaine — et ces vers
nouveaux (ils sont tirés du Buch der Lieder de 1824, plus précisément de la troisième
partie, Heimreise) le saisissent par leur musicalité si neuve et… romantique.
Schubert fait ainsi sa première incursion dans un territoire littéraire que le destin
empêchera d’explorer plus avant (Schumann, Brahms,Wolff et Mahler s’en chargeront).
Chose certaine, malgré le ton pessimiste de certains poèmes, on ne note aucun
affaiblissement des facultés créatrices de Schubert ; orienter leur perception comme
pressentiment de la mort à court terme est superfétatoire. Si Schubert se sait malade et
presque condamné, il tient toujours à s’affirmer comme la force vive de la musique à
Vienne, à le prouver par tous les moyens. Il ne faut donc pas s’étonner de l’immense
puissance de ces mélodies ; elles ne sont pas qu’éparses. Au contraire, Schubert poursuit
sur sa lancée de vouloir faire neuf dans le genre ; si le temps l’en empêche, Schumann
comprendra l’héritage, se l’appropriera et le portera à son apogée.
***
Jan Kobow est né à Berlin et débuta ses études d’orgue à la Schola Cantorum de Paris,
où il obtint le Diplôme de virtuosité. Il décrocha ensuite un diplôme en orgue et
en direction à la Hochschule für Musik de Hanovre, suivi immédiatement d’études
vocales à Hambourg avec le professeur Sabine Kirchner. Il remporta le premier prix au
11e Concours international Bach de Leipzig en 1998.
Il se produit régulièrement avec des chefs tels que Philippe Herreweghe, Frieder Bernius, John Eliot Gardiner, Gustav Leonhardt, Jos van Velthoven, Jeffrey Tate, Thomas Hengelbrock, Masaaki Suzuki, Robin Gritton, Hans-Christoph Rademann, Ludger Rémy, Andreas Spering, Morten Schuldt-Jensen, Marcus Creed, Howard Arman et René Jacobs, ainsi qu’avec des ensembles tels que l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le Freiburger Barockorchester et l’Akademie für alte Musik Berlin.
Il a un penchant particulier pour le lied, tout spécialement pour la chanson savante allemande de la période romantique. Il donne de nombreux récitals aux côtés de Graham Johnson, Cord Garben, Burkhard Kehring, Philipp Moll. Il donne aussi des récitals avec pianoforte aux côtés d’artistes tels que Leo van Doeselaar, Ludger Rémy et Kristian Bezuidenhout.
Comme chanteur d’opéra, il incarnait récemment Pamphilius dans une production d’Ariadne de Johann Georg Conradi donnée en 2003 au Boston Early Music Festival. En janvier 2004, il faisait ses débuts au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles dans le rôle de Telemaco (Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi). Jan Kobow se produit fréquemment avec l’ensemble Himlische Cantorey dont il est l’un des membres fondateurs. Il a réalisé de nombreux enregistrements commerciaux et ses récitals et concerts sont fréquemment captés pour la radio.
Il se produit régulièrement avec des chefs tels que Philippe Herreweghe, Frieder Bernius, John Eliot Gardiner, Gustav Leonhardt, Jos van Velthoven, Jeffrey Tate, Thomas Hengelbrock, Masaaki Suzuki, Robin Gritton, Hans-Christoph Rademann, Ludger Rémy, Andreas Spering, Morten Schuldt-Jensen, Marcus Creed, Howard Arman et René Jacobs, ainsi qu’avec des ensembles tels que l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le Freiburger Barockorchester et l’Akademie für alte Musik Berlin.
Il a un penchant particulier pour le lied, tout spécialement pour la chanson savante allemande de la période romantique. Il donne de nombreux récitals aux côtés de Graham Johnson, Cord Garben, Burkhard Kehring, Philipp Moll. Il donne aussi des récitals avec pianoforte aux côtés d’artistes tels que Leo van Doeselaar, Ludger Rémy et Kristian Bezuidenhout.
Comme chanteur d’opéra, il incarnait récemment Pamphilius dans une production d’Ariadne de Johann Georg Conradi donnée en 2003 au Boston Early Music Festival. En janvier 2004, il faisait ses débuts au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles dans le rôle de Telemaco (Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi). Jan Kobow se produit fréquemment avec l’ensemble Himlische Cantorey dont il est l’un des membres fondateurs. Il a réalisé de nombreux enregistrements commerciaux et ses récitals et concerts sont fréquemment captés pour la radio.







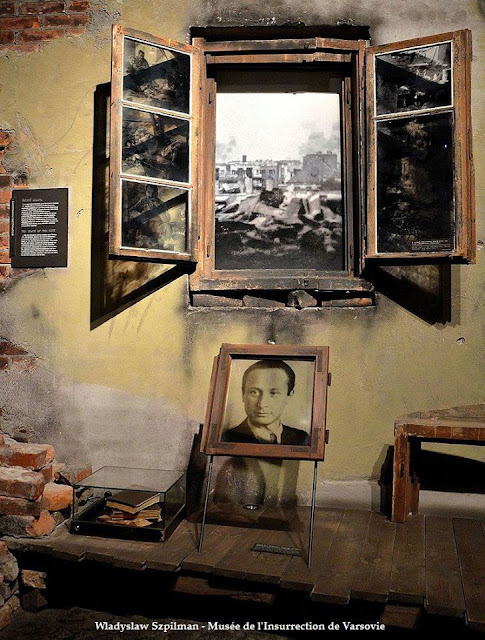



Commentaires
Enregistrer un commentaire